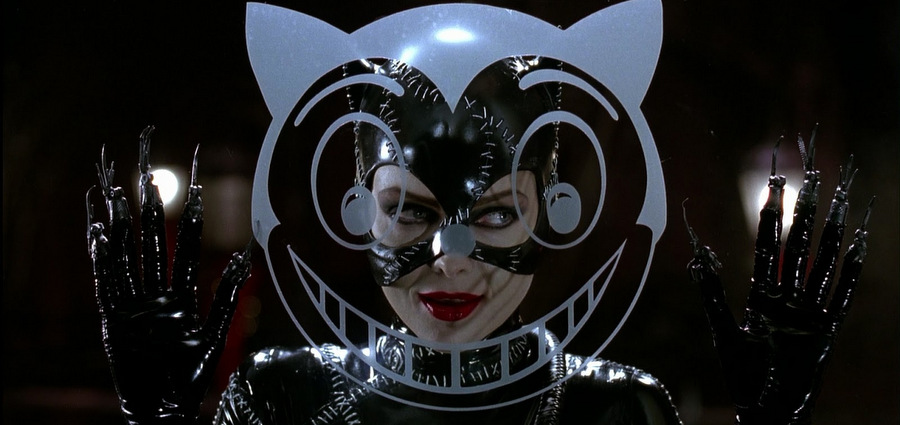Tim Burton se livre à une étonnante autocritique déguisée dans un film trop plat pour être réellement passionnant.
Il n'y a pas de scandale à dire que la carrière de Tim Burton a, depuis dix ans, pris du plomb dans l'aile. Entre serment d'allégeance à l'empire Disney — Alice au pays des merveilles — et déclinaison paresseuse de son propre style — Sweeney Todd, Dark Shadows — l'ex-trublion semblait rangé des voitures, VRP d'une signature graphique vidée de sa substance subversive.
La surprise de Big Eyes, c'est qu'il marque une rupture nette avec ses films récents. Il y a certes dans cette histoire certifiée Amérique des sixties, des pelouses verdoyantes devant des pavillons soigneusement alignés, des coupes de cheveux parfaitement laquées et des peintures bizarres d'enfants à gros yeux — celles que dessine Margaret Keane mais que son escroc de mari va s'approprier, et avec elles gloire, argent et carnet mondain ; ce n'est toutefois qu'une surface de convention, dictée par l'authenticité du fait-divers raconté plutôt que par une volonté auteurisante.
Car Big Eyes relève d'un storytelling très sage, presque plat, comme si Burton jouait profil bas pour se faire oublier derrière son intrigue et ses personnages. Il commet toutefois une flagrante erreur de casting : si Amy Adams est excellente, Waltz en fait trop, et le couple qu'ils forment à l'écran paraît déséquilibré et peu crédible. Autre lourdeur : la voix-off du journaliste qui raconte cette histoire vraie, commentaire intempestif qui ne fait que souligner des évidences sans les mettre en perspective.
Ce film scolaire et décevant dans sa facture s'avère pourtant passionnant dans son sous-texte : impossible de ne pas voir derrière cette histoire de signature falsifiée et d'imposture artistique transformée en produit commercial une autocritique de Burton vis-à-vis de sa propre carrière, comme s'il se projetait à la fois dans la créatrice sincère et dans le faussaire qui la spolie, plus docteur Jekyll que docteur Frankenstein. Il n'est pas impossible, du coup, que Big Eyes soit aussi le signe d'une renaissance...
Christophe Chabert