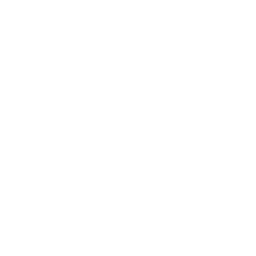The Cure : l'âge d'or
En 10 ans, de 1979 à 1989, et avant de connaître un réel essoufflement qui dure depuis plus de 30 ans – dont 14 ans de silence discographique absolu –, Robert Smith et The Cure ont livré quelques-uns des grands albums de la période et de l'histoire du rock. Huit au total. Et des chansons inoubliables qui ont essaimé bien au-delà des fans. Retour en discographie sélective – plus deux compilations indispensables – sur cette œuvre considérable qui a embrassé les années 80 par les deux extrémités. Et dont les morceaux de choix seront joués sur la scène de la Halle Tony Garnier le 7 novembre, à l'occasion d'une tournée qui fête les 30 ans de Wish, récemment réédité. Car sur scène, en revanche, The Cure n'a jamais connu de coups de mou.
Par Stéphane Duchêne
Three imaginary Boys (1979) :
Trois garçons dans les dents
Un album mythique. Essentiellement parce que c'est le premier – ce qui n'est pas rien, faut avouer – et aussi pas mal grâce à sa pochette (la fameuse « pochette au frigo », ce qui est oublier un peu vite la lampe et l'aspirateur qui sont loin de ne faire que de la figuration) qui précède une bonne demi-douzaine de pochettes toutes plus floues les unes que les autres. Bon, ça démarre quand même direct par le premier tube du groupe, 10:15 Saturday Night, sec comme un coup de trique avec sa basse têtue, sa batterie façon adjudant-chef et sa guitare erratique – et qui offrira un sample tout frais payé à Massive Attack pour son glacial Man Next Door sur Mezzanine. Il fait tellement froid d'entrée qu'on comprend mieux pourquoi le frigo du coup. De fait, c'est un peu à l'avenant de cette année, musicale, mais pas que.
En Grande-Bretagne, une dame toute froide coiffée d'une omelette norvégienne vient de prendre le poste de premier ministre et joue d'emblée les Winston Churchill : elle promet du sang et des larmes. Et tient diablement sa promesse en saignant à blanc une classe ouvrière à qui il ne reste que les yeux pour pleurer. Margaret Thatcher est en poste depuis quatre jours quand The Cure entre aux studios Morgan de Willesden, au nord de Londres. D'où le fait que Three Imaginary Boys – le morceau titre traîne en fin d'album sans guère briller – agisse comme une prémonition instantanée : comment comprendre autrement un titre comme Grinding Halt qui semble avoir été écrit sur un coin de console et qui énonce le début d'une grande, très grande, sobriété et la fin de toutes formes de haricots pour le peuple britannique : « No light / No people / No speak / No people / No cars / No people / No food / No people / Stopped / Short / Grinding halt / Everything's coming to a grinding halt » – autrement dit « Tout s'arrête brutalement ». Sur Another Day, un Robert Smith éploré à la fenêtre annonce ni plus ni moins avec ses mots que « Winter is coming » et qu'on n'est pas prêt de revoir un bourgeon. De nuit comme de jour, tous les Brits sont gris.
Plus loin, Smith se perd dans le métro – pour y connaître une fin façon Jack L'Éventreur ? (Subway Song). Sans doute la raison pour laquelle on le retrouve pendu à un crochet à viande (Meat Hook). De fait, Robert Smith, se perd beaucoup : dans le métro, dans un jardin, dans la forêt, dans la nuit, sur la plage (Smith avait écrit pour cette album, une chanson titrée Killing an Arab qui ne figurera que sur sa version américaine rebaptisée Boys don't cry et incluant le single du même nom) et dans bien d'autres endroits tout au long d'une discographie qui démontre chez le leader de The Cure un sérieux problème de sens de l'orientation.
Tout cela est bel et bien déprimant mais pas que puisqu'on note quelques ritournelles pop qui ne dépareraient pas dans la bouche et sous les doigts des Buzzcocks, autre grand groupe du moment qui refaçonne le punk à coups de mélodies pressées et précieuses. Il y a parfois quelques chose de funky au cœur de certains morceaux – du début à la fin de Three Imaginary Boys, la basse de Michael Dempsey, préhistorique à souhait, c'est ni plus ni moins que du miel. On est alors en plein essor du funk blanc tel que développé par Gang of Four. Foxy Lady, reprise d'Hendrix dont on se demande encore plus de quarante ans plus tard, ce qu'elle fiche ici, commence d'ailleurs un peu comme le Damaged Goods du Gang – et The Cure y fait volontiers trempette sur des morceaux comme Accuracy, Grinding Halt ou Fire in Cairo mi-funky, mi-étrangement doo-wop. Au milieu de tout ça, et d'une production – signée Chris Parry, directeur du label Fiction qui a signé le groupe – ascétique, cinglante, coupante comme une feuille de boucher, Robert Smith chante comme une patate germée – ça ne durera pas. Mais il faut surtout y voir comme une scorie un peu collante du punk – il suffit d'écouter So What ?, punk en diable – et parmi les morceaux dispensables du disque, soyons francs.
L'album trône encore aujourd'hui au Panthéon des grandes disques de cette grande année que fut 1979 (Unknown Pleasures de Joy Division, London Calling de The Clash, Entertainment de Gang of Four, Lodger de David Bowie, Metal Box de PiL, The Raven des Stranglers, Drums & Wires d'XTC, 154 de Wire, The Undertones de The Undertones, Singles Going Steady des Buzzcocks, côté britannique, Wave de Patti Smith, Fear of Music de Talking Heads, Eat to the Beat de Blondie, Buy de James Chance & the Contortions, N°1 in Heaven des Sparks, côté américain) année charnière qui fait entrer le post-punk dan s quelque chose de plus profond, vers un âge adulte, mais aussi en partie vers la new-wave par la face cold-wave. Rien qu'en figurant aux côtés de ces chefs d'oeuvre, The Cure réussit son entrée et trois petits banlieusards londoniens de 20 ans à peine frappent un grand coup en démontrant un savoir-faire certain dont on ignore comment il a pu laisser se perpétuer le mythe tenace selon lequel, à l'époque, les membres du groupe ne savaient pas jouer.
Seventeen Seconds (1980) :
Les secondes comme des heures
17 secondes c'est très exactement le temps qu'il a fallu à toute une génération ayant découvert The Cure avec Seventeen Seconds pour tomber raide dingue de l'album et du groupe, 17 secondes de ce morceau d'ouverture, A Reflection – au piano saupoudré de rares accords de guitare – vous faisant entrer dans un univers de brouillard mental – sublimement figurée par la floutissime pochette qui semble dessiner une forêt vue à travers une vitre nettoyée au saindoux. Un brouillard qui n'est pas sans rappeler The Fog de John Carpenter, sorti la même année. Le titre semble mener directement, par étourdissement, au premier single de cette deuxième embardée curiste, Play for today, ses percussions martiales (dont Indochine se fera malheureusement une religion et les Inconnus un sketch inoubliable), son riff tourbillonnant par-dessus la voix étranglée de Robert Smith – qui semble aller mieux mais mal, et ça va durer un moment. Une histoire de relation sentimentale forcément mal embarquée et où Robert fait tout de travers.
Car voilà que commence le premier volet de la trilogie glacée de The Cure qui, comme s'il ne faisait déjà pas assez froid en Angleterre et sur le précédent disque, a décidé d'une virée de plusieurs années chez Toupargel. Et effectivement, le disque, immortalisé au studio Morgan de Londres, semble enregistré directement depuis un congélateur géant, au point qu'on pourrait presque voir – et entendre – les stalactites de glace se former sur les cordes de la basse comme vitrifiée de Secrets – tenue par Simon Gallup qui remplace Dempsey. Avant que les mêmes ne se mettent à se réchauffer sur In your house – il fait toujours meilleur chez autrui quand on a 20 ans et froid à l'âme comme le chante Smith : « I play at night in your house / I live another life » – c'est le morceau Hÿgge de l'album : clairement, on s'y chauffe au moins à la bougie.
On déchante vite avec Three, quasi-instrumental (le chant est inaudible), l'une de ces plages sans paroles chargés de maintenir l'ambiance en sévère demie-teinte et la température autour de -4°, avant que The Final Sound, nous invite carrément au Bal des Vampires pour ouvrir la face B du disque originel, renvoyant aussi vers un single incontournable, A Forest. Soit l'histoire du petit Robert qui est encore sorti après 18h à la recherche d'une jeune fille et qui s'est encore perdu dans la forêt, où il entend des voix. Et qui, n'écoutant que son courage, prend toutes ses jambes à son cou tout entier – tentez l'expérience d'une forêt la nuit, on verra si vous n'écrivez pas un tube au riff étrangement arabisant et à la basse crispante. Après une telle frayeur, on trouverait presque M (aucun lien avec un chanteur français à la coupe de cheveux douteuse mais ici un hommage à l'éternel amour de Smith, Mary Poole) lumineux au point d'être « trapped in the light », car chez The Cure, tout est un piège dont on ne ressort, à la limite, qu'en marche arrière. Telle la nuit labyrinthique d'At Night.
Seventeen Seconds, s'il attrape l'auditeur d'entrée dans la densité de son univers de neige, n'est évidemment pas un album évident. Même les tubes sont mi-figue pas mûre-mi-noyau de raisin. De fait l'album n'accroche pas, il avale et digère l'auditeur plus que l'inverse, ce qui peut prendre un certain temps, mais figure pour beaucoup le chef d'œuvre du groupe – à débattre avec ses deux successeurs selon les écoles de pensée – notamment parce qu'il ne ménage pas la moindre concession commerciale, ce qui fait toujours du bien au snobisme. Mais aussi par son romantisme échevelé, celui d'un Robert Smith lui aussi échevelé, comme atteint d'une malédiction qui l'empêche tel un Tantale gothique (au sens littéraire du terme) d'atteindre à l'être aimé ou convoité. Cette fille qui toujours se dérobe, dans la forêt, dans la nuit, au cœur de la relation même, fantomatique, peut-être morte, sans doute irréelle, simplement fantasmée – la fille d'A Forest n'a en fait « jamais été là » – soit l'alpha et l'oméga des thématiques romantiques comme terreau de l'éploration et du suicide.
Dans le froid et la glace, comme il le chante sur At Night, Robert regarde les heures s'écouler comme la mort qui gagnerait du terrain et l'amour qui en perdrait. « Time slips away », poursuit-il sur Seventeen Seconds qui clôt l'album et qu'il faudrait presque citer en entier pour saisir l'essence de cet album, toute entière concentrée en quelques mots, entre sensation de glaciation et d'effacement de l'existence : « Time slips away / And the light begins to fade / And everything is quiet now / Feeling is gone / And the picture disappears / And everything is cold now / The dream had to end / The wish never came true / And the girl / Starts to sing / Seventeen seconds / A measure of life / Seventeen seconds ». 17 secondes, la mesure d'une vie.
Faith (1981) :
Le sceau de la Foi
N'enlevez pas votre col roulé tout de suite – mettez-en même un deuxième au cas où –, car on poursuit la plongée dans la trilogie glacée. D'autant que si sur Seventeen Seconds, il faisait froid et nuit, sur Faith c'est encore pire. Bon, plus froid que froid, on voit à peu près mais plus nuit que nuit, ça devient ésotérique. Ça tombe bien, Faith l'est quelque peu. D'où sans doute cette pochette qui figure – il faut le savoir – les ruines d'une abbaye, probablement vue à travers le cul d'une bouteille, cette fois. Il en faut ici, une bonne dose de foi : accepter de s'immerger dans cet album-linceul, c'est un peu comme se glisser l'hiver dans les draps glacés de son lit, avec cette différence que les dits draps sont, en plus, mouillés.
The Holy Hour ouvre l'affaire en mode zombie, les instruments comme vidés de toute substance, basse spectrale, batterie comme téléguidée de l'au-delà, guitare mort-vivante et Robert Smith, presque au loin qui chante depuis un ravin (dans lequel il est tombé après s'être perdu, probablement). La messe noire est déjà dite, en quelque sorte. Le single Primary, presque rageur, et dansant, apparaît presque inapproprié en un tel endroit. C'est l'entrée en matière d'un groupe qui vient d'entrer (pas complètement) dans l'âge adulte et dont deux des membres ont subi un important deuil familial (sa grand-mère pour Robert Smith, sa mère pour le batteur Lol Tolhurst). Voilà qui explique cette immersion macabre en forme de descente aux enfers, de cathédrale effondrée. Peut-être l'enfance, comme sur Primary justement, où l'évocation du premier amour semble entraîner la perte de l'innocence enfantine, comme une première petite mort succédant à et en appelant d'autres – on dit aussi que ce titre serait un hommage détourné à la figure de Ian Curtis, Robert Smith n'ayant jamais caché l'influence de Joy Division sur la gestation de Faith, cet enfant mort-né. Sur Other Voices, Robert semble carrément flirter avec une revenante ou quelque chose comme ça et la basse de Gallup fait office de draps pour la future étreinte – qui pourrait bien ne jamais avoir lieu.
Tout le reste est à l'avenant. Un avenant qui n'atteint décidément pas des sommets de fun sur des titres comme The Funeral Party, et son orgue de requiem (comme son titre l'indique), qu'Angelo Badalamenti semble avoir beaucoup écouté avant de composer le thème mythique de la série Twin Peaks, ou The Drowning man (qui décrit le funeste destin de Fuchsia, héroïne du roman de fantasy gothique Gormenghast de Mervyn Peake, ce qui rabattra vers The Cure nombre de fans gothiques).
Il n'y a que Robert Smith pour, dans une telle atmosphère d'hiver nucléaire, balancer des chansons fiévreuses d'une voix qui ne l'est pas moins (pas de doutes, le chanteur fait des progrès fulgurants) comme sur le morceau-titre, longue complainte à la rythmique façon supplice chinois dans laquelle il affirme ni plus ni moins que même la foi ne sauvera personne mais qu'en plus ses dévoiements conduisent au pire (une petite référence à la longue histoire de l'église catholique avec le viol d'enfant est ici très imagée). Le titre clôt quasiment l'album – un instrumental lui succède – dans un climax de nihilisme qui agit presque comme un cliffhanger pour le prochain.
Si Seventeen Seconds était un album romantique, Faith est son pendant fantomatique, gothique, traversé sans aucune forme d'espoir, quand son prédécesseur en ménageait un minimum. Boys do cry, définitivement.
Pornography (1982) :
Le bruit et l'impudeur
Seventeen Seconds était blanc, Faith était gris, (rouge et) noir devait être Pornography pour clore cette trilogie glacée – qui se réchauffe à un drôle de brasier. Certains y voient le chef d'œuvre à la fois du triptyque et du groupe mais il est quasi avéré dans l'histoire des arts que le troisième volet d'une trilogie est rarement son pinacle. Alors il faudra sans doute choisir entre les deux précités. Comme c'était prévisible, Pornography est un peu l'album de tous les excès (le groupe n'y survivra d'ailleurs pas, du moins pendant un temps), une œuvre au noir, un long poème nihiliste, qui annonce la couleur d'entrée, autrement grandiloquente sur One Hundred Years que sur les deux précédents disques.
À côté de Pornography, Seventeen Seconds et Faith faisaient office de volcans endormis recouverts de glace. Ici le volcan explose. Et le talent de Robert Smith aussi, qui était pourtant déjà bien installé : The Cure progresse à pas de géants dans l'innovation musicale et sonore – évidemment, aujourd'hui la production a vieilli – dans ce qui pourrait être considéré comme un album indus – on retrouve ici des motifs arabisants (les guitares de The Figurehead, maquillées en saillies gothico-westerns), des rythmiques martiales et même tribales, des rythmiques de messe noire (la palme à The Hanging Garden, ce jardin suspendu qui donne envie de se pendre : « Creatures kissing in the rain / Shapeless in the dark again / In the hanging garden change the past / In the hanging garden wearing furs and masks / Fall, fall, fall, fall / Into the walls / Jump, jump out of time / Fall, fall, fall, fall / Out of the sky / Cover my face as the animals die »). Certains diront que l'album est un peu à Robert Smith ce que Metal Machine Music fut à Lou Reed, un terreau d'expérimentation un peu opaque. C'est un peu exagéré mais il y a un fond de vérité.
Pornography se mérite, on ne dompte pas facilement cette bête infernale, mais chaque titre trouve un moyen d'accrocher l'auditeur dans un mode opératoire qui délaisse le mode passif-agressif pour l'agression pure et simple, la montée au front, l'envie d'en découdre avec tout ce qui bouge ou même ne bouge plus, à commencer par soi. La voix de Smith n'est plus plaintive mais le plus souvent étranglée de rage, il n'est plus un enfant perdu, un ado frustré, il est un (jeune) homme en colère et en butte à tout ce qui l'entoure. En proie surtout à une armée de démons qui semble s'avancer en convoi funéraire sur Cold et son orgue/synthé pour requiem biblique – qui d'autre que Robert peut fantasmer le réveil d'après l'amour en veillée funèbre et traiter l'amante endormie comme un cadavre : « A shallow grave / A monument to the ruined age / Ice in my eyes / And eyes like ice don't move / Screaming at the moon / Another past time / Your name like ice / Into my heart / Everything as cold as life / Can no one save you? / Everything as cold as silence / And you never say a word »
Smith confessera souvent se révéler vindicatif lorsqu'il a bu et le fait est que durant la période il boit plus que de raison, ceci expliquant peut-être cela. Mais il ne fait pas que boire quand sur A Short Term Effect, il expérimente la descente – et pas qu'aux enfers : « A day without substance / A change of thought / The atmosphere rots with time / Colors that flicker in water / A short term effect ». D'une manière générale Robert, qui s'inflige une séance d'auto-exorcisme en même temps que d'autodestruction, semble remâcher sur Pornography une gueule de bois repeinte à la bile et on l'entend particulièrement sur Siamese Twins. Le noir et rouge de la pochette – sur laquelle les trois membres du groupe (flous bien entendu) semblent brûler en enfer – c'est le noir d'une croûte nécrosée sur une plaie qu'on gratte en un geste quasi SM : « I chose an eternity of this / Like falling angels / The world disappeared / Laughing into the fire / Is it always like this? / Flesh and blood and the first kiss / The first colors, the first kiss » puis plus loin « Dancing in my pocket / Worms eat my skin / She glows and grows / With arms outstretched / Her legs around me / In the morning I cried ».
Sur The Figurehead, Smith, en pleine dépression, peut-être au bord du suicide, déverse une longue litanie confessionnelle de désespoir (« I would never be clean again », répète-t-il comme un mantra final). Il confiera alors s'être vraiment confessé une nuit à une sculpture de crâne qu'il avait achetée sur un coup de tête (preuve donc que ça allait pas top top dans la période) et en avoir tiré une chanson (magie de la résilience).
Comme Faith clôturait Faith et Seventeen Seconds achevait Seventeen Seconds, c'est le titre Pornography qui cloue le cercueil de l'album, dans une ambiance aussi carpenterienne tapissée de guitares distordues. Robert Smith y gueule, comme du fond de chiottes murés pour en faire une tombe en carrelage : « One more day like today and I'll kill you / A desire for flesh / And real blood / And I'll watch you drown in the shower / Push my life through your open eyes / I must fight this sickness / Find a cure / I must fight this sickness ».
Si Robert Smith a pu voir sa trilogie glacée comme une thérapie, il en ressort probablement plus mal qu'en y entrant. Il s'est certes peut-être trouvé mais dans quel état et à quel prix. Le public, lui, a trouvé un groupe qui semble comprendre ces états d'âmes les plus sombres et même, en les montant en mayonnaise, les sublimer. Pornography le bien nommé est ainsi un acte d'impudeur quasi sacrificiel dont Smith et le groupe ne retrouveront jamais la formule – mais la dépasseront sur Disintegration – faisant de Pornography un album jalon pour toute une génération et pour un groupe arrivé à maturité, accouchant de lui-même dans un torrent de sang et de larmes, Churchill au musée des horreurs.
The Top (1984) :
Flop of the pop
Il n'est pas impossible que quand on annonce la couleur de manière si explicite non seulement c'est le signe qu'on n'est pas certain de ce qu'on livre mais en plus on s'expose à un retour de bâton. Autrement dit, baptiser un album The Top, qui plus est quand on vient de livrer quelques classiques coup sur coup, c'est un poil risqué. Et donc patatras : The Flop, voilà comment les Curistes ont surnommé ce disque. Rejeté à la fois par les puristes inconditionnels de la trilogie glacée et par les fans plus tardifs – folkloristes goths ou consommateurs de tubes en boîte – The Top est un album charnière, qui devrait donc réunir à peu près toutes les nuances de fans de The Cure. Mais c'est une charnière molle, branlante, qui ne soutient rien, qui n'unit rien.
C'est en tout cas le discours obligé, peut-être un peu paresseux. Car à y regarder de plus près, on peut y voir Robert Smith – qu'on a laissé subclaquant et parlant à des crânes à la fin de Pornography – renaître de sa poussière de cendres. Et opérer la métamorphose du cloporte chère à Alphonse Boudard – bien sûr comme dans La Métamorphose des Cloportes, rien ne se déroule comme prévu. Car il n'est pas fringant fringant, ni forcément très inspiré à force d'avoir confit dans l'alcool, le Robert. Mais il y a une intention sans laquelle, probablement, la suite n'eut pas été la même. On sent un songwriter qui cherche sa nouvelle voie après trois chefs d'œuvre bizarre et une dépression plus classique, et c'est infiniment émouvant – cela beaucoup de Curistes ont un peu oublié de le voir.
A l'époque Smith est vraiment sur la brèche, au bord de la schizophrénie musicale. D'un côté, il cherche donc une nouvelle voie pour The Cure, de l'autre, il fricote très assidûment avec Siouxsie and The Banshees (dont il est un temps le guitariste) et notamment avec Steve Severin, le guitariste. Les deux hommes, qui aiment traîner ensemble, s'infligent durant leur temps libre des séances cinématographiques à coups de films d'horreurs qui donnent des cauchemars au leader de The Cure et lui inspirent des chansons (l'inspiration est une drôle de fée).
Enfin, poussé par son management, il a écrit quelques tubes légers, dont le jazzy parodique The Lovecats, inspiré des Aristochats, ou Let's Go to Bed, un genre de disco tout à fait singulier dans un premier temps dans la bouche d'un type aussi plombé – et impropre à la consommation pour le fan hardcore moyen. Deux morceaux efficaces mais qui ne lui ressemblent guère pour l'instant, et que Smith juge foncièrement « stupides ». Comme un certain nombre des titres qui figureront sur l'album compilation Japanese Whispers, où l'on trouve également le japonisant The Walk, plus gros succès britannique de The Cure jusqu'alors. Voyant bien que ces titres ont du succès, les méprisant férocement mais trouvant là quelque chose comme une formule (y apparaît l'un des tics smithiens : ce cri à mi-chemin de Jayne Mansfield et du chat de gouttière), influencé par son travail avec Siouxsie, Smith est perdu.
The Top tente de faire la synthèse, y échoue et, par là, ouvre une autre voie qui s'avérera sans issue. Surtout, Smith est seul. En réalité, après l'éclatement du groupe consécutif à la folie Pornography – pendant l'enregistrement duquel le trio s'est déchiré en studio sur des montagnes de cadavres de bouteilles. Alors, il cherche en jouant de tous les instruments et de toutes les drogues qui lui tombent sous la main – il finira aux urgences après l'enregistrement de New Day, non conservé sur l'album.
En quelque sorte, il continue de creuser le sillon de Pornography mais celui-ci est évidemment tari, en jachère, incendié. Smith n'étant pas manchot, il en tire quand même quelques pépites, comme ce classique étrangement léger qu'est The Caterpillar, jolie déclaration d'amour atonale qui contraste avec la torpeur zombie du très indus The Top. Ailleurs, Robert joue les Castafiore sur Piggy in the Mirror nappé de synthé et saupoudré d'espagnolades (un drôle de truc) ou se la joue Suicide sur l'hypnotique Bananafishbones. Mais pour Robert l'esseulé, le morceau de bravoure du disque est son morceau d'ouverture, Shake Dog Shake, un des incontournables du groupe en concert, qu'il tient lui-même pour l'un de ses meilleurs morceaux. Peut-être parce se deux premières strophes semblent annoncer la mue de The Cure, sorti des enfers de Pornography pour tenter de trouver une voix vers la lumière : « Ha ha ha / Wake up in the dark / The after-taste of anger in the back of my mouth / Spit it on the wall / And cough some more / And scrape my skin with razor blades / And make up in the new blood / And try to look so good / Follow me Make up in the new blood / And follow me to where the real fun is / Ha ha ha. »
The Head on the door (1985) :
La tête au carré
Après les singles « stupides » du début de la décennie, The Head on the door fait entrer The Cure dans le monde pop et dans une ère de succès commercial. « Follow me where the fun is » semble continuer de nous dire Robert comme dans ce vers de Shake Dog Shake. Le titre fait référence à une phrase de Close to me, l'un des plus grands succès du groupe, et évoque un cauchemar récurrent du jeune Robert : une tête traversant la porte de sa chambre (bon...). Ce disque, façonné et réalisé en groupe (tout le monde s'est rabiboché et le guitariste Porl Thompson rejoint le groupe) après la hiatus solitaire que fut The Top, ce qui influera beaucoup sur sa forme, Smith le voit davantage comme un assemblage de tubes, potentiels ou avérés, que comme un album à part entière.
La chose commence par l'une de ces chansons tueuses de trois minutes douche comprise dont Smith a le secret quand il sort de la déprime, une bombe pop hyperactive, hautement addictive, sur laquelle à peu près tout le monde a dansé au moins une fois dans sa vie et qui s'avère être le titre de la percée américaine du groupe et du début de la Curemania en France : Inbetween days. Ces jours de l'entre-deux au synthé obsédant sont une fois encore un genre de Ne me quitte pas smithien.
Ne pas se méprendre pour autant, sur cet album pop, Smith n'abandonne pas pour autant ses obsessions macabres. Dès Kyoto song, deuxième titre de l'album à la mélodie japonisante à la Sakamoto, marotte occasionnelle du compositeur, il se réveille aux côtés d'un cadavre sans qu'on sache s'il s'agit d'un cauchemar ou non. Preuve de l'éclectisme stylistique du disque, The Blood est un quasi flamenco mais punk aux évocations christiques (il n'y a que Smith pour pondre ce genre de gloubiboulga). La preuve avec le morceau suivant, Six different ways, qui mêle piano-bastringue et cette flûte qui tourbillonne comme un bourdon.
Plus classique, Push pourrait être un proto-Just Like Heaven – qu'on retrouve sur Kiss Me Kiss Me Kiss Me deux ans plus tard – et aurait fait un tout aussi bon générique pour Les Enfants du rock. C'est l'un de ces morceaux du groupe dont l'introduction est plus longue que le reste de la chanson – Smith s'avouera souvent adepte du flirt, ce moment introductif d'une relation on l'on s'échine à ne pas conclure. Bien entendu on trouve encore un morceau japonisant avec le très tonique The Baby Scream et sa guitare-laser, un funk blanc en la personne de The Screw (ce n'est pas en se prenant pour David Byrne que Robert est à son meilleur, soyons honnêtes) et une ballade atmosphérique aux porte du prog-rock avec Sinking – ces trois morceaux étant là pour faire le nombre.
Les véritables vedettes ici, ce sont Close to me, sans doute le morceau de Cure le plus joué à la radio, que le groupe vient à l'époque interpréter chez Michel Drucker (« mesdames, messieurs, Zeu Kiour ! »), Robert Smith et son groupe sur une scène de 3m2, le cheveu en apothéose nucléaire, devant un public effaré de retraités de l'assurance et de Sue Ellen des Hauts-de-Seine – et A Night like this, objectivement l'une des plus belles chansons écrites pas Smith où, dans des trémolos bouleversants entièrement gâchés par un saxophone éclaté, il répète : « je veux tout changer ».
Mais au fond, c'est peut-être dans les paroles de Six different ways que réside l'essence même de ce disque. On pourrait voir le morceau comme une évocation des troubles de la personnalité, tendance multiples, mais on peut y déceler aussi une confession de Smith sur sa manière de se multiplier artistiquement pour contenter tout le monde (avec même l'évocation de ce tyran qu'est le marché américain) ce qui revient au même, on en conviendra : « This is stranger than I thought / Six different ways inside my heart / And everyone I'll keep tonight / Six different ways go deep inside / I'll tell them anything at all / I know I'll give them more and more / I'll tell them anything at all / I know I'll give the world and more / The think I'm on my hands and head / This time they're much too slow / Six sides to every lie I say / It's that American voice again / It was never quite like this before / Not one of you is the same / This is stranger than I thought / Six different ways inside my heart / And everyone I'll keep tonight / Six different ways go deep inside »
Staring at the sea – the singles (1986) :
Simples et basiques
Beaucoup de fans hardcore, ou d'amateurs plus distanciés, ont, du fait de leur âge moins avancé que les Curistes séminaux, découvert The Cure avec cette compilation au succès non démenti qui recense tous les singles du groupe depuis ses débuts, à commencer par les singles qui ne figuraient que sur la version américaine du premier album comme Killing an Arab (et son intro façon Mille et une nuits), Boys don't cry. Le titre de la compilation, parfois également appelée Standing on a beach, est extrait d'un vers de Killing..., inspirée de la scène du meurtre sur la plage de L'Etranger de Camus.
Agencé dans l'ordre chronologique, Staring at the sea, dont la pochette au vieil homme (un pêcheur à la retraite qui matérialise l'amour de Robert Smith pour les ambiances iodées, lui qui est né à Blackpool, cité balnéaire du sud – enfin, sud, c'est un bien grand mot – de l'Angleterre) est entrée dans la légende, est alors une excellente introduction à l'œuvre du groupe de Crawley puisqu'elle marque l'évolution esthétique de The Cure et exalte les qualités de songwriter de Smith, aussi doué pour les compositions atmosphériques et les expériences vers l'au-delà – de la musique mais pas seulement – que pour distiller des tubes à l'envie et sous des formes diverses et variées. Elle permet aussi de noter l'évolution de The Cure, de sa production – et des diktats sonores des différentes époques – si l'on considère que Killing an Arab, en introduction, semble joué dans le cul d'une vache quand A Night like this en clôture semble enregistré dans une cathédrale de poche.
Au fil des titres et donc du temps, le son s'ouvre, la production s'étoffe et on finit par respirer un peu à mesure que les fantômes du punk et du pas-de-chichis s'éloignent. Sur l'album on trouve bien évidemment quelques jalons essentiels du groupe, quelques gonds autour desquels le groupe a pivoté et fait ses révolutions, souvent à l'écart des albums comme Charlotte Sometimes ou Let's go to bed, auquel tout le monde s'est plus que fait avec le temps. Car c'est l'une des marques des grands groupes que d'être soucieux de ne pas venir gâter un long format avec leurs meilleurs titres et de les proposer à part comme la sauce de la salade si elle est vraiment bonne.
Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987) :
La bouche pleine
Sur la pochette en très gros plan confinant à l'abstraction de Kiss Me Kiss Me Kiss Me : des lèvres, celles d'un Robert Smith qui a toujours eu un rapport ambigu à la bouche et au baiser. Une chose potentiellement dégoûtante selon lui. « Your tongue is like poison » commence-t-il dès la première ligne de ce double album entamé dans un déluge absolu de distorsion. Plus loin, à l'amante, il hurle : « I wish you were dead ». Eros et Thanatos étant le couple idéal chez le jeune homme de Crawley. Puis vient trancher Catch, gentille pop song très Velvet Underground sur le souvenir d'une jeune fille qui tombait, que Smith décrira lui comme son Walk on the Wild Side. Un contraste qui annonce d'entrée la couleur ou plutôt les couleurs de l'album. Un album qui clignote, dira Smith, un fatras foutraque, sans doute l'album le plus positivement barré de The Cure, et donc le disque de tous les extrêmes ou de toutes les extrémités – enregistré en Provence au célèbre Studio Miraval, signe de certains privilèges d'un groupe qui commence à faire gagner de la caillasse à la maison-mère. Un album démocratique aussi, où chacun a pu déverser des idées, une partouze créative d'une rare – trop grande ? – richesse mais qui rencontre, peut-être pour cette raison – et sans doute grâce au terrain balisé par les précédents, un succès plus grand encore que The Head on the Door.
Le disque, tout du long, alterne ainsi les moments de fureur comme Shiver and shake, quasi noise et no wave, sur lequel Smith hurle dans un sommet d'amour-haine : « You're a fucking waste / You're like a slug on the girl / Oh you're useless and ugly / And useless and ugly / And I shiver and shake » , de noirceur sur If Only Tonight We Can Sleep et son sitar (en fait un synthé), Snakepit et One More Time, autres inspirations possibles de Badalamenti pour Twin Peaks, décidément, et signe peut-être qu'ici Robert radote – One More Time n'est pas non plus sans rappeler Six Different Ways sur The Head on the Door.
De temps à autres, Robert & Co ont comme des envies de se détendre. Et virent carrément funk, pour le groupe, et soul pour le chanteur, sur Hot Hot Hot !!!, un truc à la Chic qui fait un drôle d'effet waow (ou beurk, suivant sa religion). C'est que Robert raconte, dans la chanson, avoir été frappé par la foudre – celle du coup de foudre, bien sûr – et ne se sent plus. D'où ce côté fête à neuneu. Même programme peu ou prou sur Why Can't I Be You qui évoque la solitude d'un homme qui n'a pas toujours envie d'être à sa propre place, ne serait-ce que pour ne pas avoir à se fader les autres (s'il était eux, donc). C'est tordu mais c'est dansant, Robert chantant la chose comme on fait virevolter une toupie (la toupie c'est lui) rebondissant d'un cuivre à l'autre. De cuivres, cet album généreux en est plein (trop, sans doute, encore une fois mais c'est l'époque) même sur des morceaux empreints d'inquiétante étrangeté comme Torture, des embardées de punk circassien à la Hey You – un peu trop Le Plus grand cabaret du monde pour être apprécié – ou une bizarrerie club-jazz comme Icing Sugar.
Et puis il y a les hymnes de pure pop à guitare comme Smith semble pouvoir en pondre à la pelle comme How Beautiful You Are ou le mythique Just Like Heaven, l'une des plus pures pop songs qui soient. Si pure que les producteurs de l'émission Les Enfants du Rock en firent leur générique entré dans la légende et que des dizaines de groupes de rock se sont jetés dessus pour en livrer leur propre version (une palme à celle, conquérante et dégingandée à la fois, de Dinosaur Jr.).
Sur cet album, Robert Smith est capable de livrer des chansons à l'émotion à fleur de peau comme le très synthétique et éploré A Thousand Hours (une sorte de sequel de la maturité à Seventeen Seconds) ou de chanter Fight, un genre d'hymne à la combativité, lui le champion du monde de l'abattement, qui semble être un signe de l'acceptation de la réussite du groupe et des combats qu'il a fallu mener pour y arriver. Où est-ce le libéralisme triomphant de l'année 87 qui a fait succomber Robert du côté obscur de la gnaque (là où sévissent les Patrick Bateman) quand il chante cet espèce d'anti-Grinding Halt : « Fight fight fight / Just push it away / Fight fight fight / Just push until it breaks / Fight fight fight / Don't cry at the pain / Fight fight fight / Or watch yourself burn again / Fight fight fight / Don't howl like a dog / Fight fight / Just fill up the sky / Fight fight fight / Fight til you drop / Fight fight fight / And never never / Never stop. » On imagine que quelques Curistes en proie à la neurasthénie comme philosophie de vie ont dû remiser leurs vieilles éditions de Schopenhauer et Sylvia Plath pour reprendre deux fois du Guronsan, sont morts de fatigue après avoir pris la folle décision d'aller courir ou simplement de désespoir d'avoir été trahis par ce discours à mi-chemin de Ronald Reagan et TiboInshape. Un triple baiser, certes, mais de Judas.
De fait, Kiss Me Kiss Me Kiss Me est un album difficile à appréhender malgré l'évidence de la plupart des titres. Il déroute car invite l'auditeur sur trop de chemins – le groupe semble n'avoir rien voulu laisser de côté. C'est un véritable labyrinthe qui contient presque à lui tout seul toute l'œuvre de The Cure et qui marque une fois de plus une réalité du groupe en cette année 87, en caractérisant sa folie, créatrice surtout, une certaine euphorie peut-être induite par le succès, au fond – d'où peut-être aussi le délire Fight. On ne retrouvera plus The Cure dans de telles dispositions, éparpillé façon puzzle et comme intarissable. Kiss Me Kiss Me Kiss Me, fut une explosion, en forme de smack, comme il y en a peu dans la vie d'un groupe. Qui trop embrasse...
Disintegration (1989) :
la disparition de Robert Smith
Terminus, tout le monde descend, fini l'euphorie et la créativité quasi destructrice. Avec Disintegration – tout est dans le titre – toutes ces belles dispositions se désagrègent, s'étiolent, se délitent. Mais comme on est chez The Cure et que Robert Smith n'est jamais aussi bon que quand il l'a mauvaise, cela ne signifie en rien que Disintegration a à souffrir de la comparaison avec son plantureux prédécesseur. C'est juste que les deux n'ont rien à voir.
Toute cette période révolue, cette belle insouciance, comme seules les années 80 ont pu nous en tracer les contours illusoires, Robert semble l'enterrer dès les premières notes, sublimes, planantes comme un linceul dans la brise, de Plainsong et cette introduction qui s'avance comme un paquebot gris qu'on traîne à l'échafaud. Lui chante d'une voix presque monocorde et si réverbérée qu'elle semble nous parvenir de l'au-delà. Tout cela ne pouvait pas durer : au sortir de la tournée Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Robert Smith nous fait une belle dépression (comme après chaque album), n'assumant plus son statut d'icône pop, et vire Lol Tolhurst qui boit trop – c'est-à-dire selon les critères de Smith qui a lui-même la main lourde en matière d'alcool, dans des proportions bibliques. C'est dans ce contexte qu'il se met à écrire, de nouveau seul, après la parenthèse démocratique du précédent album, les chansons de Disintegration sur la pochette duquel il apparaît en filigrane ou comme une ondine coincée sous une vitre, ectoplasmique, fantôme de lui-même, comme une apparition en proie à la disparition.
En tout cela, Robert est en réalité une fois encore, assez raccord avec son temps. N'oublions pas que 1989, date de sortie de cet album enregistré à Checkendon aux studios Hookend, est l'année des grands effondrements, de la fin des utopies, en même temps que celle de la triste victoire du capitalisme. Une victoire à la Pyrrhus où étrangement le peuple n'a rien à gagner, contrairement à ce qu'on croyait, et où le combat, le Fight, se livre surtout pour les autres et la préservation de leurs richesses. Pour l'occasion, avec ce disque qui est encore une fois le plus grand succès du groupe (4000000 d'albums vendus) The Cure abandonne donc la pop échevelée (écervelée) de The Head on The Door et Kiss Me Kiss Me Kiss Me pour des morceaux plus atmosphériques aux longues plages synthétiques, si maussades, si abandonnées au renoncement qu'on pourrait presque y voir une forme d'apaisement (on reconnaît bien là notre Robert).
Cela n'empêche pas les tubes et les tours de force. Comme par exemple de faire un hit, Lullaby, qui hante longtemps notre Top 50, avec une chanson sur, au choix, l'insomnie, les abus sexuels ou les problèmes de drogue (les spéculations sont nombreuses sur la signification de cette chanson et sur la nature du fameux homme-araignée qui hante les nuits sans sommeil du petit Robert pour se repaître de lui) ; pondre un sommet de mélancolie avec une chanson d'amour pour une fois positive (Lovesong, nouvel hommage à sa femme Mary, l'amour de sa vie, et sans doute l'une des chansons les plus émouvantes du songwriter). Ou simplement rendre aussi addictif des titres au climat si marmoréen (à cet égard, le monolithique, avec son riff de sitar, mais langoureux, Pictures of You est un cas d'école) ; laisser entrevoir autant de lumière dans un climat si brumeux éclairé par une âme aussi noire. Tout ici semble avancer d'un pas lent mais résolu, parfois léger comme sur Lullaby, parfois carrément martial comme sur Closedown et Prayers for Rain et leur batterie militaire, et même mortifère sur Last Dance, chansons toutes trois à propos du temps qui passe et nivelle tout, de l'amour qui fane – thématique partagée par Pictures of You.
Le chant de Smith, jamais autant à son affaire que sur ce disque, est comme une longue complainte, qui semble regretter sa grandeur pourtant pas vraiment passée, sur Homesick, ou son incapacité à faire les choses comme il faudrait sur Untitled qui clôt l'album. Mais on y décèle malgré tout une certaine combativité (Fight a laissé des traces, sans doute) et malgré tout l'empreinte d'une espérance lorsque sur The Same Deep Water As You il conclut : « I will kiss you, I will kiss you / I will kiss you forever on nights like this / I will kiss you, I will kiss you / And we shall be together ». Seule lueur d'espoir, bienvenue, avec Lovesong.
Il n'y a guère que Fascination Street, autre single de l'album avec Lullaby, pour emprunter un rythme différent et varier la thématique. Smith y fantasme Bourbon Street, la rue de la soif de La Nouvelle Orleans, mais dans une évocation où sourd une espèce d'inquiétude presque braillée. Le titre est redoutable mais le véritable chef d'oeuvre de Disintegration, qui n'en manque pas, c'est justement Disintegration, la chanson-titre. Comme une concession élastique à la danse, au milieu de ce fatras de mélancolie, le titre agit comme un poison, une séance d'hypnose, une descente en spirale longue de près de huit minutes placée à un moment où l'auditeur est au bord de l'épuisement. Et c'est sans doute ce qui l'emporte. Smith y évoque, porté par des synthés en mille-feuilles et des accords en colimaçon, sa disparition.
Il nous abandonne là, lassé du cirque pop, de son hypocrisie et de ses faux-semblants, plein de rancœur qu'il déverse ici une bonne fois pour toutes, comme s'il devait s'agir du dernier album de The Cure.Il se désintègre, s'autodétruit, prend la tangente comme on s'engage sur l'autoroute vers le Paradis. Livrant là l'un des morceaux les plus obsédants et les plus émouvants qu'il ait jamais écrit. Disintegration eut d'ailleurs pu être le dernier morceau du disque, c'eut été parfait. On n'aurait, en plus, plus jamais entendu parler de lui, que sa sortie aurait été tout bonnement magistrale.
Il y a bien sûr débat à propos du meilleur ou plus bel album de The Cure. Selon l'approche que l'on a du groupe, la période qu'on lui préfère, l'année où l'on a fait sa découverte. Mais objectivement, Disintegration n'est pas loin d'être l'œuvre la plus aboutie, cohérente, et représentative de la psyché smithienne, tout en restant abordable au commun des mortels – la trilogie glacée étant un peu obtuse. Surtout le songwriter n'a peut-être jamais fait si bien passer dans sa musique à la fois un état d'esprit intime et quelque chose comme un zeitgeist. Il suffit pour s'en convaincre d'absorber les paroles de Plainsong en préambule du disque : « "I think it's dark and it looks like rain, " you said / "And the wind is blowing / Like it's the end of the world, " you said / "And it's so cold, it's like the cold if you were dead" / Then you smiled for a second / "I think I'm old and I'm feeling pain, " you said / "And it's all running out / Like it's the end of the world, " you said / "And it's so cold, it's like the cold if you were dead" / Then you smiled for a second / Sometimes you make me feel / Like I'm living at the edge of the world / Like I'm living at the edge of the world / "It's just the way I smile, " you said »
La fin d'un monde, oui, définitivement, la fin d'une époque dorée aussi pour The Cure, qu'on ne connaîtra plus jamais tutoyant ces hauteurs musicales, la fin de l'état de grâce d'un songwriter qui semble en avoir soudainement la prescience quand sur Kiss Me Kiss Me Kiss Me, il se pensait visiblement éternel, intarissable, immortel.
Remix
Mixed Up (1990) :
The Cure façon puzzle
MMixed Up, comme son nom l'indique n'est pas un album original mais une collection de remixes. Une sorte de récréation-recréation pour un Robert Smith aspirant au fun après être sorti complètement schlass de Disintegration. Il n'en est néanmoins pas moins une œuvre importante (reniée par la plupart des fans) par les versions qu'il donne à voir des titres de The Cure – certains parmi les plus célèbres et populaires composés par Robert Smith. On pourrait même utiliser quelques-uns de ses morceaux comme exemple s'il nous prenait de remettre en cause la passionnante théorie de l'oeuvre canon propre à la musique enregistrée, et particulièrement la musique pop, développée par Agnès Gayraud dans son Dialectique de la pop.
La plupart des versions proposées ici (Lullaby, Fascination Street, Lovesong...) sont des Extended Mix déjà présents en face B de 45t, soit des versions déformatées car non destinées à passer à la radio. Sauf que par exemple un morceau comme Lullaby, berceuse macabre si murmurée par Smith qu'il semble entrer en lui-même, semble avoir été écrit pour être comme ici étiré à l'infini (soit 7'45'', un bail pour une chanson pop), alangui sur des plages de violons, une guitare soporifique et un synthé au goût métallique de Stillnox, jusqu'à ce qu'un sommeil inquiet, ou une crise de nerfs, s'impose. Idem pour Lovesong, l'un des titres les plus positivement romantiques écrits par Smith, son « I will always love you » puisque tel est le refrain martelé ici, ou Hot Hot Hot !!!, titre tombé du turgescent Kiss me Kiss me Kiss me et méchante embardée funky, quasi, marmonnée par un Robert Smith littéralement mué en chef chaudard.
De même pour Pictures of You, ralenti en machine dub par Bryan « Chuck » New, où trône mollement la voix réverbérée de Robert (dont cet album rend au moins grâce aux qualités de chanteur – et même de crooner à l'occasion – peut-être trop souvent sous-estimées). D'autres remix ont été réalisés tout exprès pour Mixed Up, comme celui de Close to me dont le grand DJ Paul Oakenfold sublime la basse profonde et le rythme syncopé en un quasi reggae. C'est bien simple, Close to me semble avoir été composé pour cette version. Autre curiosité d'un as du remix : Inbetween Days, pimpée par William Orbit, dans une étonnante version club rafalée d'électronique.
Mais les deux coups de maîtres de l'album sont clairement The Walk et A Forest. Ce n'est sans doute pas un hasard si, faute de bandes originales disponibles, The Cure a réenregistré ces deux titres avant de les remixer. Cela donne un très carpenterien The Walk, merveille de production qui voit Smith lâcher les chiens de son tropisme japonisant et jouer de la boîte à rythmes en virtuose. Et puis il y a A Forest, et son Tree mix, une tuerie intégrale sans doute supérieure de loin à sa version originale pourtant mythique. Ici les guitares et la basse sont rondes comme des queues de pelles, la rythmique toujours aussi martiale, et l'ensemble flirte peu ou prou avec un genre de western post-rock crépusculaire dans une version paradoxalement lumineuse pour un titre si noctambule (pour rappel : Smith perdu dans la forêt la nuit à la recherche d'une fille qui n'existe pas). Au lieu de se déliter comme dans la version de Seventeen Seconds, ici tout s'emballe pour s'achever en apothéose avec certaines des plus belles parties de guitare jamais jouées par le groupe. Cette version servira de base pour des versions live épiques dépassant parfois les dix minutes et constituant le climax des shows de The Cure.
Mixed Up comprend également un morceau inédit dont la version originale constitue donc le propre remix, ce qui est original. Mais ce n'est pas tout. Réédité en 2018, notamment pour le fameux Record Store Day, Mixed Up, désormais rebaptisé pour l'occasion Torn Down, compte désormais trois disques, le second ajoutant des remixes, souvent bien plus dispensables, d'autres titres incontournables (Let's go to bed, Boys don't cry, The Lovecats, Just Like Heaven), d'autres versions de Close to me ou Pictures of you et un Why Can't I Be You qui ne figurait que sur la version cassette de Mixed Up, l'ensemble étant trop long pour figurer sur CD.
La véritable affaire se trouve en réalité sur le troisième disque de ce tripe vinyle qui compte pas moins de 16 morceaux, soit un (et pas forcément les plus évidents) par album du groupe, tous remixés par Robert Smith en personne. Mais d'une, l'ordre chronologique (et la perte d'inspiration induite au fil du temps et des dits albums) dessert un peu le projet : on n'a à peu près que faire d'un remix tiré de Galore ou Bloodflowers, soyons honnête). En dehors de trois titres de la période glacée, M, The Drowning Man, et A Strange Day, dont Smith restitue bien l'inquiétante étrangeté originale par des voies parfois superbement détournées ou magnifiquement exploitées (un morceau comme A Strange Day est à la base suffisamment déstructuré pour être malaxé à l'envi), la plupart des remix de cet album ne sont ni fait ni à faire – le Time to kill mix de Never Enough porte ainsi cruellement bien son nom et celui d'A Night Like This et son saxophone au top de la ringardise est atroce – soit que Smith ne se foule pas, soit qu'il en fait beaucoup trop (les remixes de Lost et It's Over qui donnent la migraine. Comme s'il fallait soudain être raccord avec l'exergue figurant sur la pochette façon action painting de Mixed Up. Exergue que l'on doit à Jules Renard et qui dit : « cherchez le ridicule en tout, vous le trouverez ».
Bonus track :
Wish (1992) :
Un vœu pour la route
Trois ans après Disintegration, The Cure, passé dans une nouvelle décennie, semble vouloir reprendre les choses là où ce grand album auto-destructeur les avait laissées. Non, Robert n'a pas abandonné ses ouailles, il continue de nous dire qu'on y va tout droit et que ça ne saurait tarder. De ce point de vue Open, qui ouvre Wish, est un peu un nouveau Plainsong, sorte de coup de maître introductif à la résonance anxiogène. Mais l'atmosphère est plus noisy que les contours planants de Disintegration. D'ailleurs, disons-le d'entrée, Wish n'arrivera pas à la cheville de son prédécesseur. Mais il a au moins le mérite de proposer un peu plus qu'une chanson correcte par-ci par-là comme ce sera le cas de ses successeurs. C'est un vrai bon album, le dernier bon album du groupe – fruit d'une des sessions les plus productives qu'ait connu Robert Smith selon ses propres dires –, qui plus est plutôt raccord avec ce qui est produit à l'époque, ce qui prouve que Robert Smith est toujours aussi prompt à saisir l'ère du temps.
Il n'en demeure pas moins que l'album, réédité cette année pour son trentième anniversaire, est la plus grosse vente du groupe, qui surfe alors clairement sur la notoriété invraisemblable construite pendant une décennie à coups de disques souvent magistraux et de chansons iconiques. En cela, il est caractéristique de ces albums charnières qui marquent l'exact endroit du début du déclin artistique d'une formation et de son pic commercial combiné. Les deux courbes se croisent et la critique, en ce point de croisement a déjà déserté, tandis la génération suivante de musiciens, forcément plus inspirée puise paradoxalement dans l'œuvre de ladite formation – c'est qu'il y a là de quoi alimenter plusieurs écoles de pop et de rock. D'ailleurs, l'album avance sur le même terrain que ces jeunes groupes qui font l'indie-rock triomphant du moment. Les synthés s'effacent au profit des guitares et d'un son, d'un soin, plus indie, plus attaché aux morceaux qu'à l'ensemble univoque qu'ils pourraient former. À part peut-être en ce qui concerne le son qui semble avoir été pensé pour le live – et la tournée sera dantesque.
Quelque chose semble avoir changé chez Robert Smith, une fois atteint l'âge du Christ lorsqu'il confie sur End : « I think I’ve reached that point / Where giving up and going on / Are both the same dead end to me / Are both the same old song », comme s'il ne courait plus après rien. Et prend ce qui vient comme il semble le chanter sur Friday I'm in Love : « I don't care if Monday's blue / Tuesday's grey and Wednesday too / Thursday, I don't care about you / It's Friday, I'm in love / Monday you can fall apart / Tuesday, Wednesday break my heart / Oh, Thursday doesn't even start / It's Friday, I'm in love ». Autrement dit, la semaine peut bien être une vraie tartine de merde, du moment que l'amour est au rendez-vous du vendredi...
Robert Smith grandit, vieillit, mûrit, devient un sage. Bien sûr la mélancolie adolescente est toujours à l'oeuvre comme sur le très cinématographique Trust et son intro qui sort les méga-rallonges, ou A Letter to Elise et son piano de bric et de broc. Les atmosphères ombrageuses également, qu'il s'agisse de l'ouverture Open, de la clôture End, ou du très glauque Apart et son psychédélisme aqueux. Lui et ses ouailles savent aussi se montrer aussi tranchants que dans leurs jeunes années avec le rouleau compresseur From The Edge Of The Deep Green Sea ou le noisy Cut sans pouvoir résister une fois de plus à la tentation noisy de Wendy Time, assez tarte il faut bien le dire. Mais la légéreté s'invite à la fête sur Friday I'm in Love donc, un enfant de Just Like Heaven de plus, High et ses guitares virevoltantes où Robert Smith nous refait le coup du chat chantant ou encore le bondissant Doing The Unstuck dont il ponctue chaque couplet d'un « Let's get happy » qui n'a jamais vraiment été le genre de la maison, à la limite du Carpe Diem.
À l'occasion des 30 ans du disque, Wish est réédité en version Deluxe sous la forme d'un double LP. Avec une version remasterisée (à Abbey Road et entre autres par Robert Smith lui-même) de l'album. Et 24 titres inédits incluant des démos et quelques instrumentaux. Et surtout quatre chansons de l'EP Lost Wishes, à l'époque publié uniquement en cassette et version limitée et donc devenues cultes avec le temps.
Précision importante. 30 ans après sa sortie, comme la plupart des grands albums qui l'ont précédé – pas tous – Wish n'a pas vieilli d'un poil.
The Cure
À la Halle Tony Garnier, le lundi 7 novembre 2022 à 20h