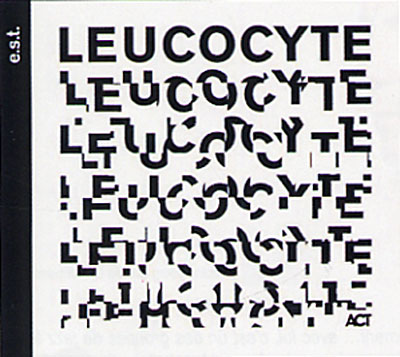Avec "Tucson Songs", spectacle relayant l'album du même nom, l'Épicerie Moderne nous présente la relève de la scène musicale de Tucson, poussée entre cactus, vieux cow-boys à moustache et autres figures tutélaires (Giant Sand, Calexico, Jim Waters) qui ont fait l'histoire d'une ville pas comme les autres.Stéphane Duchêne
«En terre humaine/Je suis d'Arizona», murmurait Murat en 1999 sur le titre Viva Calexico. Cette même année, pour son album Mustango, baroud d'honneur d'un cow-boy alors sur le retour, l'Auvergnat succombait à l'appel de Tucson, Arizona, et y trouvait une inspiration rarement égalée depuis. Si en espagnol, Tucson se prononce «Touquesonne», en américain, on dit «Tout Sonne», ce qui dans notre langue si lacanienne prend tout son sens, tant dans la cité arizonienne tout sonne, résonne d'un même élan. Celui d'un mélange musical sans cesse ravivé par l'hybridation hispano-américaine et l'esprit d'ouverture d'une ville à cheval sur plusieurs cultures : native-américaine, western et hispanique.
Dire qu'à Tucson, «the smallest big city in the USA», on pratique une musique de cow-boy et de desperado serait très certainement un cliché, mais il se trouve que la pop culture vit et meurt par le cliché. La ville elle-même en est un. Surnommée «The Old Pueblo», le nom même de Tucson vient du o'odham (une des nombreuses langues uto-aztèques qui s'étendaient, en plusieurs branches et zones éparses, du territoire des Utes (aujourd'hui l'Utah) à l'Amérique centrale (jusqu'au nord de l'actuel Costa Rica)) : «Cuk Son» («au pied de la montagne noire») en référence au positionnement du site au pied d'un volcan, la ville étant cernée de montagnes. La tradition western y est immense, puisque furent tournés dans les environs des films aussi mythiques que Rio Bravo, Duel au soleil ou la première version de 3h10 pour Yuma – rappelons que l'État d'Arizona comprend des sites aussi mythiques que le Grand Canyon, Flagstaff, Yuma, et à sa frontière avec l'Utah Monument Valley).
Ramirez
Théâtre des guerres apaches mais aussi américano-mexicaine, la ville est logiquement imprégnée de toutes ces cultures qui ont fait l'histoire et la géographie de l'Arizona. Tucson est donc surtout une ville d'implantation. Si la population y est en majorité blanche – on y compte une proportion très faible de noirs-américains – elle est pour un bon tiers originaire du Mexique tout proche. Pas étonnant que l'un des symboles culturels de cette ville musicalement très vivante soit le cow-boy moustachu Teodoro «Ted» Ramirez.
Désigné par le maire de Tucson en 2001, comme «troubadour officiel» de la ville, Ramirez est une figure patrimoniale de la ville, descendant direct de la première famille hispanique installée à Tucson. Avec son Santa Cruz River Band, Ted a sans doute été l'un des premiers à mêler, tant sur des chansons originales que sur des «traditionals», le folk du Sud-Ouest des États-Unis et la musique traditionnelle mexicaine et même européenne. Il fait donc un peu office, avec son Santa Cruz River Band, de gardien du Temple musical local.
Lequel est aussi un terrain d'innovation intellectuelle et artistique. La ville abritant l'Université d'Arizona (plus de 35 000 étudiants) créée en 1885, quand l'Arizona n'était encore qu'un «territoire» américain et ce n'est pas anodin : comme dans toutes les villes moyennes sous perfusion universitaire (Austin au Texas, Athens en Georgie, encore elles) l'effervescence estudiantine et ce creuset de savoir ont favorisé l'émergence d'une scène musicale alternative particulièrement riche qui doit autant aux traditions locales qu'au mélange opéré par l'arrivée d'étudiants venus de tout le pays (majoritairement de Californie, d'Illinois, du Texas, de New York).
Et si Ramirez est parfois qualifié de chaînon manquant vivant entre passé et présent, sans doute Calexico est-il l'un des maillons suivants, entre passé et futur, dans l'ombre d'une autre figure tutélaire mais bien plus ombrageuse : Howe Gelb. C'est pourtant son Giant Sand, ovni musical aux 27 albums (sans compter les albums solos et projets parallèles de Gelb), qui a engendré Calexico, via deux de ses membres originels justement : Joey Burns et John Convertino. Bien qu'arborant le nom d'une ville californienne, à cheval sur la frontière avec le Mexique, Calexico s'est rapidement imposé comme le véritable catalyseur artistique de la scène locale. Entre tradition et modernité, comme on dirait, en ne plaisantant qu'à moitié.
Cable Hogue
À partir de la fin des années 90, entre rock indépendant, expérimentations, alternative country, musique mariachi, embardées vers la chanson française, exploitation du mythe de l'Ouest (The Ballad of Cable Hogue, inspirée du film du même nom), Calexico a tout joué mais surtout fédéré, invitant ou s'invitant sur les disques des autres : de The Fitzcarraldo Sessions à The Band of Blacky Ranchette, d'OP8 (avec Howie Gelb et Lisa Germano, petit chef d'œuvre de douceur) à la BO d'I'm Not There, film biographique sur Dylan, sur laquelle on n'est pas prêt d'oublier cette vibrante reprise de Goin' to Acapulco avec Jim James de My Morning Jacket. Comment oublier également cette prestation au Barbican Theatre de Londres, disponible en DVD aux côtés de la troupe Luz de Luna, l'un des plus fameux orchestres de Mariachis de Tucson, dirigé par une autre grande figure locale : le facétieux trompettiste (et ténor) Ruben Moreno ?
Au fil d'une carrière impeccable, le groupe a non seulement entraîné toute une relève mais aussi touché une poignée d'admirateurs français devenus collègues de travail. Certains faisant même le voyage jusqu'à Tucson pour bénéficier des lumières de Calexico et de la lumière du désert : on pense à Marianne Dissard (exilée quasi permanente qui a quand même trouvé le moyen de rafler des récompenses en France), Françoiz Breut (complice régulière du groupe), French Cowboy, et Murat donc.
Mais derrière toute cette effervescence, se cache également un producteur incontournable auquel la jeune génération continue de se raccrocher : Jim Waters, patron du studio Waterworks, qui en plus de Jon Spencer, Sonic Youth et The Married Monk a produit tout ce joli monde. Tous sont sans doute venus y chercher cette touche si particulière, qui sent bon le désert et l'urine – Waters lui-même aime à raconter qu'il fait nettoyer son studio par Old Pablo, un vieil Indien qui vit à côté de chez lui et qui distillerait dans le lieu une subtile odeur d'urine qui rappelle celle des vieux saloons.
Parmi les talents qui émergent d'une bonne tête, on compte Brian Lopez (auteur d'une ébouriffante reprise western de Killing Moon d'Echo & the Bunnymen), également produit par Waters et que par commodité on qualifiera de "crooner". Echappé d'un groupe de rock expérimental, il serait tentant de ne voir en lui qu'un Jeff Buckley (de plus) du désert puisque son registre est bien plus vaste. On pense à Anthony & the Johnsons, Roy Orbison ou même Ian McCulloch avec une musique qui sur son album Ultra dégage une grand mélancolie à la fois western et post-rock. Il y a aussi Andrew Collberg – dont la voix oscille parfois étrangement entre celle de Joey Burns et celle de John Lennon – un demi-Suédois passé par la Nouvelle-Zélande, qui est devenu l'un des piliers de cette nouvelle scène avec ses balades up-tempos qui nous emmèneraient au fin fond du désert. Symbole d'un chanteur qui semble avoir trouvé sa place et qui, comme Murat en 1999, a fini par se fondre dans le décor.