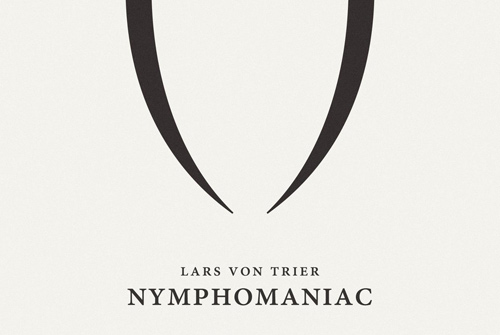Les Sorcières de Zugarramurdi. Nymphomaniac volume 1. Ida. Tonnerre.
Le festival du cinéma européen des Arcs — et les Journées DIRE, on va expliquer tout ça assez vite — fait irrésistiblement penser à un film (européen) récent, L'Enfant d'en haut d'Ursula Meier. La station vit sur quatre niveaux d'altitude, de Bourg Saint-Maurice aux Arcs 2000, et il s'agit de faire la navette — littéralement, ce qui, un jour de neige, fout autant le vertige que d'assister à sa première projection de Gravity — entre les différents sites. Et plus on monte, plus c'est la profession — exploitants, distributeurs, presse — qui s'accapare les lieux, tandis que le public reste majoritairement en bas — ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas droit à d'excellents films, bien au contraire.
Le festival se répartit ainsi en trois grandes sections : la compétition, composée de films inédits ; les avants-premières et les séances spéciales, qui mettent en avant quelques événements à venir dans l'actualité cinématographique — comme les derniers Nicole Garcia et Patrice Leconte, ou le biopic d'Andrzej Wajda sur Lech Walesa... ; et enfin un panorama, cette année consacrée au cinéma de l'ex-yougoslavie, avec beaucoup de très bonnes choses comme la première palme d'or d'Emir Kusturica, Papa est en voyage d'affaires, le mythique J'ai même rencontré des tziganes heureux ou encore, plus récent, le sulfureux Clip, sorti cette année sur les écrans français.
Enfin, il y a donc les fameuses journées DIRE, où les Distributeurs Indépendants Réunis Européens viennent montrer un film de leur choix parmi leurs prochaines sorties, avec en ligne de mire des tables rondes réfléchissant à la manière de diffuser le cinéma européen dans les salles.
C'est essentiellement là-bas qu'on a pioché notre programme du festival... Ainsi du très attendu nouveau film d'Alex de la Iglesia, Les Sorcières de Zugarramurdi. Sur la foi du pitch — suite à un braquage en plein cœur de Madrid, trois hommes et un enfant se retrouvent dans un petit village à la frontière hispano-française, persécutés par les sorcières qui ont pris possession du lieu — on s'attendait à voir De la Iglesia revenir à la comédie fantastique telle qu'il la pratiquait dans Action mutante ou Le Jour de la bête. La première séquence, celle du hold up, rappelle d'ailleurs la fusillade en pleine grande rue de Madrid de ce dernier ; c'est une véritable déclaration de guerre politique, une sorte de lecture absurde de la crise espagnole, où les malfrats se déguisent en Christ, en GI Joe ou en Bob l'éponge pour commettre leur méfait, à savoir dévaliser une boutique de rachat d'or. Les symboles de l'église et du divertissement de masse à l'assaut de la fortune amassée par des usuriers modernes profitant de la précarisation ambiante, pas de doute, on est bien dans le cinéma en colère de De la Iglesia.
Passée cette intro impressionnante, que le cinéaste met en scène avec un sens du chaos visuel déjà à l'œuvre dans son chef-d'œuvre Balada triste, le film va toutefois changer d'angle d'attaque, et s'avérer certes virtuose et généreux, mais quand même un peu problématique. Car Les Sorcières de Zugarramurdi vire rapidement au pamphlet anti-féministe, les personnages (masculins) se plaignant perpétuellement de l'ascendance prise par les femmes dans la société — droit de garde des enfants après le divorce, insatisfaction chronique, désir d'indépendance financière... Un discours qui, au générique, se traduit par une galerie de portraits de femmes de pouvoir parmi lesquelles on reconnaît Margaret Thatcher et Angela Merkel, puis dans l'intrigue du film par une vaste sarabande dont le point culminant est le moment où les sorcières tentent de créer un antéchrist androgyne qui servirait de leurre et de réponse au machisme chrétien. On est presque dans du Éric Zemmour, même si, et on en a eu confirmation par la suite, on sent aussi que la vie personnelle de De la Iglesia a motivé la charge.
Si tout le monde s'amuse à l'écran — à commencer par deux habituées de son cinéma, Carmen Maura et Carolina Bang, et le spectateur avec elles, il y a aussi un effet d'épuisement qui se crée sur la longueur. De la Iglesia surenchérit sans cesse, remplit les scènes jusqu'à la gueule d'idées, de dialogues, de mouvements de caméra et d'effets spéciaux. On sort aussi lessivés de Zugarramurdi que de Balada triste, mais avec un arrière-goût bizarre dans la bouche, le même que celui éprouvé à l'époque d'Antichrist de Lars von Trier : celui d'un règlement de compte perso qui se perd en généralités contre le sexe opposé, regardé avec un mélange de fascination et de crainte.
Lars von Trier, justement, était au cœur de toutes les conversations mardi soir suite à la présentation du premier volume de Nymphomaniac. Le film a divisé les festivaliers comme il avait divisé la presse lors de sa projection parisienne quelques jours auparavant. Ici, on aime beaucoup cette première partie, qui rompt avec la logique dépressive du cinéaste et marque son retour à une forme de légèreté, certes toujours provocatrice, mais particulièrement ludique. Surtout, il est porté par une inspiration (presque) constante, une envie de cinéma total, extrêmement figuratif tout en restant littéraire et, c'est une des surprises de Nymphomaniac, mathématique. On n'en dit pas plus, car on en reparle dès mercredi prochain par ici...
L'autre film qui a beaucoup fait parler de lui au festival, c'est Ida du Polonais Pawel Pawlikowski. Aussi brève (1h15) qu'imposante, c'est une œuvre d'une perfection formelle stupéfiante. Quand on dit formelle, on ne parle pas que de la mise en scène, en soi hallucinante de précision avec ses plans en 1.33 noir et blanc composés au cordeau, souvent décadrés, toujours à la bonne longueur et à la bonne distance... La maniaquerie du cinéaste commence dès le scénario, qui travaille chaque scène avec de subtils conflits dramatiques, qu'ils soient internes ou externes, tout en reliant ensemble la grande Histoire polonaise (la deuxième guerre mondiale, la mauvaise conscience nationale envers les Juifs exécutés par les Chrétiens, mais aussi la chape de plomb du pouvoir socialiste, le film se déroulant dans les années 60) et le parcours romanesque de son héroïne. Même la direction des acteurs relève de la chirurgie : on a parfois le sentiment qu'on les entend compter la juste durée des silences et des regards...
Cette perfection-là, indéniable, a son revers : elle étouffe l'émotion légitime que ce récit terrible devrait produire chez le spectateur. En vissant à ce point son film, Pawlikowski le vitrifie aussi — un reproche qu'on pouvait déjà adresser, à une moindre échelle, au Heimat d'Edgar Reitz. C'est peut-être de la pudeur, un refus du pathos, une sorte d'ascèse qui renverrait au statut d'Ida elle-même, qui veut devenir nonne mais se met à douter quand elle découvre ses origines juives en se rapprochant d'une tante alcoolique et dépressive. Cela peut aussi passer pour un exercice un peu vaniteux où l'artiste se placerait au-dessus de ses personnages, à tous les sens du terme. En résumé, Ida, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus le chef-d'œuvre annoncé — peut-être parce que, justement, le film lui-même annonce un peu trop qu'il en un.
On terminera en disant quelques mots du premier film de Guillaume Brac, Tonnerre. Brac n'est pas un inconnu, puisqu'il avait fait le tour des festivals de courts avec son multi-récompensé Un monde sans femme. Il retrouve ici le désormais incontournable Vincent Macaigne, en rocker déprimé qui choisit de retourner vivre chez son père — Bernard Menez, qu'on se plait toujours à retrouver sur un écran — dans la petite ville de Tonnerre, connue surtout pour son vin blanc. Là, il y fait la connaissance d'une très jeune journaliste — Solène Rigot, sorte de Léa Seydoux en plus rugueuse — venue l'interviewer, et dont il va tomber amoureux.
Le film démarre sur un ton de comédie romantique un peu grise, pas déplaisant d'ailleurs, même si Brac rate ce qui sans doute était un de ses objectifs principaux : faire se rencontrer la fiction avec la réalité du lieu, les acteurs professionnels et des habitants dans leur propre rôle. C'est un fantasme qui parcourt en ce moment une partie du cinéma français, de La Bataille de Solférino à Elle s'en va : faire se croiser le monde «réel» et les scénarios inventés, comme si l'un allait donner une plus-value d'authenticité à l'autre. Dans Tonnerre, c'est l'inverse qui se produit : les «vrais» gens viennent plutôt souligner la gaucherie d'acteurs qui, certes, ne sont pas exactement des comédiens de composition. En gros, tout le monde a l'air de jouer faux, et c'est un handicap sérieux dont le film peine à se remettre.
La demi-heure centrale, qui plus est, souffre vraiment d'une absence d'enjeux dramatiques forts, mais aussi d'un évident manque d'ambition dans la mise en scène. On a le sentiment d'assister à un téléfilm France 3 région en plus neurasthénique, et il faut attendre le dernier acte pour que l'action redémarre. Brac cherche alors à donner une autre ampleur à son récit, en l'emmenant vers les rives du mélodrame criminel façon Les Amants de la nuit. C'est de loin ce qu'il y a de plus réussi dans Tonnerre, même si les défauts déjà évoqués restent présents. Comme souvent, on se dit qu'on aimerait parfois voir directement le deuxième film de certains jeunes cinéastes français, tant l'exercice du premier long semble paralyser certains dans leur créativité et leur envie d'en découdre avec la matière cinématographique, les acteurs, le romanesque...