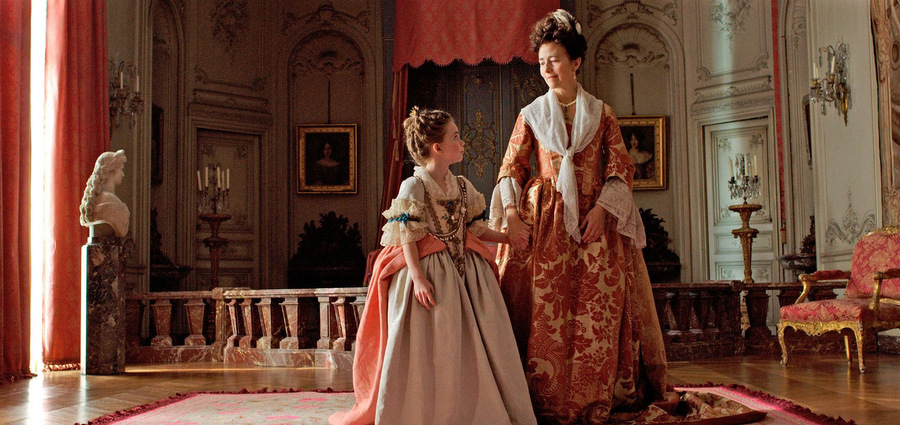L’Événement / Parmi les invités d'honneur du 30e festival de Sarlat, la réalisatrice Audrey Diwan tout juste laurée de son Lion d'Or à la Mostra de Venise pour le coup de poing L'Événement — est au centre de toutes les attentions depuis que Bac Nord (qu'elle a coscénarisé) triomphe au box-office. L'occasion de reprendre avec elle le fil d'une conversation entamée en 2019 entre Avignon et Gérardmer...
Lors de notre précédente discussion, à l'époque de Mais vous êtes fou, vous évoquiez déjà votre travail sur l'adaptation de L'Événement...
Audrey Diwan : J'avais déjà commencé il y a deux ans ? Au bout d'un moment on ne sait plus : comme les livres, les films et les histoires d'écriture nous portent, c'est difficile de circonscrire la période de travail. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais au livre depuis longtemps — je l'avais lu quelques années avant.
L'angle que vous avez choisi, c'est raconter l'histoire dans le film au présent alors que le récit par Annie Ernaux dans le livre est au passé...
Je crois que c'est la clé que je cherchais. D'abord, c'est toujours complexe de mettre en scène l'auteur cherchant son œuvre — mais ça peut se faire. Ensuite, ce qui me plaisait moins dans cette idée, et la raison pour laquelle j'ai élagué cette partie du texte, c'est que si j'avais montré Annie Ernaux en train de regarder cette histoire, je l'aurais mise dans le rétroviseur, donc j'en aurais fait une histoire passée. Or ce qui m'intéressait, c'était de tenter de proposer une expérience qui s'écrive au-delà de l'époque — parce que, quand on n'est pas ethnocentrique, on sait que ces histoires ont toujours lieu dans d'autres pays — et au-delà du genre, c'est-à-dire qu'on puisse la partager que l'on soit une femme ou une homme.
C'est donc, malgré quelques marqueurs des années 1960, une histoire contemporaine...
Oui. Sur le plateau, on désignait cela par la “stratégie de l'instant”. On avançait pas à pas dans les années 1960, sans chercher à faire de reconstitution mais à entrer dans une époque, à la vivre plus qu'à la regarder.
Comment avez-vous choisi votre comédienne principale, Anamaria Vartolomei ?
C'est toujours une question cruciale, mais vu le dispositif, c'était plus important encore : je savais que l'actrice SERAIT le film. Et qu'il fallait que je pose les quelques critères sans lesquels je ne pensais pas pouvoir faire le film. D'abord, il fallait quelqu'un ayant déjà tourné auparavant, donc qui ait déjà dompté la caméra — le chef-opérateur était souvent à proximité, elle devait garder sa liberté de jeu dans un telle promiscuité. Après, je cherchais quelqu'un avec une présence forte et Anamaria au casting avait la particularité de ne pas du tout chercher à me plaire. Elle était vraiment elle-même avec plus de questions que de volonté de séduire — et ça correspondait au personnage d'Anne. Ensuite je me suis rendue compte qu'elle avait un jeu relativement minimaliste : beaucoup d'émotions pouvaient passer avec peu — ce qui est important quand le choix du cadre est l'hyperproximité : un haussement de sourcil, un demi-sourire peut sembler déjà énorme. Avec quelqu'un qui aurait eu un jeu démonstratif, le film n'aurait pas été regardable.
Et il y avait rapport au texte, très important : imaginer que cette jeune femme est étudiante en lettres, qu'un jour elle va devenir autrice... Ça veut dire qu'il fallait avoir un rapport à la sémantique... À la fin de notre première séance de travail, je lui ai demandé de lire Victor Hugo, Aragon... Les auteurs cités dans le film. Tous les acteurs ont eu des devoirs [rires].
Y a-t-il eu de la part des interprètes une appropriation particulière du sujet du fait de ses résonances politique et sociale ?
C'est très étrange, l'histoire de ce film. Quand j'ai commencé à travailler dessus, tout le monde me disait : « mais pourquoi le faire maintenant ? » comme s'il n'avait aucune forme d'actualité. J'ai compris chemin faisant que ce qu'on appelle “l'actualité” est ce qui figure au cœur des sujets de discussion ; ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. J'ai essayé de défendre l'idée qu'il y avait énormément de pays où l'avortement était interdit : l'Amérique latine, l'Afrique, avant même les histoires en Pologne. Et c'est au cours de l'écriture que le sujet est redevenu un sujet de discussion, qu'il s'est ethnocentré. Ça c'est encore intensifié avec le Texas, mais quand on a appris pour le Texas, on était en route pour Venise. Il fallait défendre le sujet alors que souvent pendant le parcours de financement, on m'a dit « oui, mais pourquoi faire un film sur ce sujet ? La loi est déjà passée » — ce que je trouve être un argument particulier. C'est comme si je disais : « la prochaine fois qu'on vous propose un film sur la Seconde guerre mondiale, vous le direz aussi ! ». Le tabou par rapport à ce genre de sujet me permettait de comprendre qu'il était nécessaire de faire le film.
Sur l'engagement des acteurs et des actrices, j'ai l'impression que tous les gens qui sont montés à bord l'ont fait avec conviction. Le film était rythmiquement dur à faire : on avait du travail, surtout avec le système de mise en scène, tout le monde est extraordinairement lié. Il fallait que le point arrive sur le bon acteur au bon moment, qu'il tourne la tête au moment où Anamaria le regarde... C'était très chorégraphique, on ne pouvait pas faire le film autrement que soudés les uns aux autres.
Pour moi le film n'avait d'intérêt que si on arrivait à en faire une expérience, si on arrivait à impliquer les sens. C'est pour ça qu'il y a un travail sur la durée, qu'on a fait ensemble. Comment on étend les scènes pour que cette sensation ne soit pas théorique. Et pour sortir du théorique, pour faire partager une sensation, il faut penser la durée. C'est pas facile à faire sur le plateau.
Il y a chez le personnage d'Anne le très fort sentiment d'appartenir à une classe sociale populaire, qui dans le film s'incarne principalement dans les séquences chez ses parents...
Le principe du personnage, qui est un transfuge de classe, faisait partie des grandes idées qui me donnaient envie de traiter le sujet. S'il n'avait été question que d'avortement clandestin, ç'aurait été un film à thèse ou à sujet — et ce sont des films où je m'ennuie un peu. Ce qui m'a séduite, touchée et frappée dans le livre, c'est cette dimension, le rapport au social. La transfuge de classes s'incarne vraiment dans ce chemin qu'elle doit faire toutes les semaines pour aller de l'univers des parents, plus prolétaire, jusqu'à la fac qui est l'univers bourgeois, avec le sentiment qu'elle n'appartient plus à l'un et pas encore à l'autre. Le parcours du transfuge de classes est un peu comme l'apatride : il n'est plus tout à fait chez lui nulle part, ça rajoute à sa fragilité.
Et le rapport au féminin, au corps, au sexe s'ajoute à la condition sociale. La manière dont on juge le plaisir : qu'est que c'est une “fille facile”, une “salope” — tout ce qui est dans le livre, les mots employés pour désigner les filles qui n'étaient pas des bourgeoises et qui n'avaient pas de rapport au corps et aux hommes. Toute cette dimension sociale du sexe a infusé à plein d'endroits. Mais pour moi, le film n'est pas du tout moral : je n'ai pas de jugement sur les personnages, ni les hommes ni les femmes. Chacun est le reflet d'une société, d'un moment, d'un rapport à ce silence. Tellement de chose s'ignorent aujourd'hui... J'ai été surprise en lisant L'Événement ; Anamaria l'était et nombre de jeunes à qui l'on en parle aujourd'hui... Personne ne se doute de ce que c'est que cette réalité.
Pensez-vous que depuis la loi 1975 en France, la société ait occulté, volontairement ou inconsciemment, toute cette période-là ?
J'ai toujours l'impression que les Droits de la Femme sont des acquis que l'on obtient un peu à l'arraché et qu'ensuite on nous dit : « chut, n'en parlons plus ». « Vous avez le droit ». Cette manière de nous dire qu'on a le droit me fait toujours sous-entendre que ce n'est que temporaire : « vous avez le droit pour le moment, n'en rajoutez pas ». Annie Ernaux m'avait quand même dit que, quand L'Événement était sorti au début des années 2000, c'était de tous ses ouvrages celui qui avait été le moins couvert par les médias en général.
Il y a un effet thriller, avec le décompte des semaines de grossesse, ou la séquence chez la “faiseuse d'anges”.
C'était déjà dans le livre, via une phrase qui m'avait marquée, qui disait en substance : « le temps avait cessé d'être une succession de jours à remplir, de cours et d'exposés. Il était devenu cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi ». De toutes façons, il y a une part de thriller et une part horrifique.
L'univers de la faiseuse d'anges, dans la représentation que je m'en faisais, est proche de la sorcellerie — mais je veux dire pourquoi. Je trouve qu'on s'arrange très bien pour mettre des mots qui ne font que caresser la réalité de loin : faiseuse d'anges, ce n'est pas très précis, on ne sait pas trop ce qui se passe... Ça n'est qu'une réalité relative dans l'esprit des gens et j'aimais qu'elle représente ça et qu'elle nous emmène ensuite vers la réalité de ce processus. Elle a une forme d'inquiétante étrangeté. J'aime une histoire quand elle se dit dans le corps. Je pense que c'est un rapport concret à la narration que je peux préférer à une forme de psychologisation excessive — j'y suis plus sensible. Et c'est le courant littéraire auquel, dans ma tête, appartient Annie Ernaux qui de Eribon à Édouard Louis raconte la résonance entre le corps et son histoire, sa classe sociale, le milieu, le déterminisme. Dans le livre, elle dit “je me suis faite engrosser comme une pauvre”. C'est-à-dire que si elle avait eu de l'argent elle aurait trouvé le moyen de changer de pays, ce qui lui aurait permis que ça n'arrive pas de la même manière. Les stigmates que ça laisse dans le corps et la tête, c'est un rapport à sa position dans le monde et de femme. Je suis très touchée par l'histoire du corps.
L'affiche renvoie à celle d'Une Affaire de femmes de Chabrol, avec ce regard qui prend à témoin. A-t-elle été pensée en référence ?
Si c'est le cas c'est inconscient ! J'avais une idée très précise de l'affiche, que j'avais très mal dessinée. Ce que je voulais, c'est être à l'épure comme l'est le reste du film : on connaît tout de suite la situation, on est dans la proximité, dans la franchise...
Qu'est-ce que le Lion d'Or a changé ?
Si je vous répondais rien ? [rires]. La première chose, c'est qu'on s'est battu pour faire le film, en espérant que le sujet et le film en général seraient mis en lumière ; là, c'est extraordinaire toutes ces opportunités que l'on a de le montrer. Ça change pour moi autre chose : le degré de liberté que j'aurai pour le prochain, allant de pair avec un degré de pression, je m'en rends bien compte...
Puisque vous êtes toujours scénariste, vous êtes sur le prochain film de Valérie Donzelli...
Qui est encore une adaptation, de L'Amour et les Forêts de Éric Reinhardt. Mais ce qui est drôle c'est que l'adaptation n'est pas un exercice uniforme. Il y a autant de livres que d'adaptations ! On vient de finir. Et j'adapte aussi L'Amour ouf de Thompson Neville parce que je collabore avec Gilles Lellouche pour son prochain film...