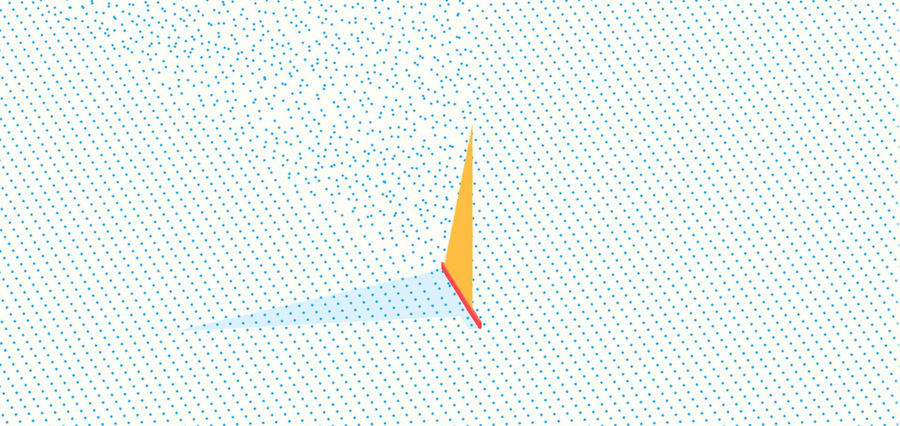Un vrai bonhomme / Pour son premier long-métrage, Benjamin Parent s'aventure dans un registre peu coutumier en France : le “coming at age movie“ — une sorte de film d'apprentissage adolescent. Une jolie réussite dont il dévoile quelques secrets. Attention, un mini spoiler s'y dissimule...
Un thème commun se dégage de votre film Un vrai bonhomme et de Mon inconnue que vous avez co-écrit avec Hugo Gélin : l'uchronie, ou l'idée de permettre à des personnages d'accomplir des destinées alternatives. Est-ce délibéré ?
Benjamin Parent : Pas du tout. Dans Mon Inconnue, l'idée d'uchronie vient d'Hugo ; j'ai essayé de développer la dramaturgie sur l'uchronie “la plus intéressante“. Je trouve que l'uchronie permet de raconter l'histoire d'une manière extrêmement drastique, avec ce truc d'inversion absolue des choses : “et si“ on pouvait rencontrer ses parents et qu'on se rendait compte que son père était un blaireau et que sa mère voulait nous choper, qu'est-ce qu'on ferait ? L'uchronie, finalement, c'est un pitch radical, qui permet plein de possibilités et un déploiement de l'imaginaire.
Un vrai bonhomme, où le personnage de Léo est une extension de celui de Tom, permet également le déploiement de l'imaginaire. Donc du vôtre à travers eux...
Effectivement. Mais plus qu'une uchronie, cela joue sur le principe de ce que l'on montre, avec un personnage qui n'est pas supposé être là et qui va donner un peu de sel à l'ensemble. Cela me plaît justement de provoquer l'imaginaire avec quelque chose qui n'existe pas. Il est vrai que mes deux films ont en commun d'évoquer ce qui n'existe pas, sauf que Un vrai bonhomme pourrait être tourné sans la présence de Léo, avec Tom qui parle tout seul et s'énerve...
Mais ça ne serait pas cinématographique...
Ce serait littéral, sur un ado en colère, comme La Tête Haute avec une approche un peu plus naturaliste. J'avais envie d'avoir un côté “cinéma“ comme les films que je regardais plus jeune, plus dans le divertissement et plus “photographique“. Ou d'avoir des personnages qui courent sur des voies ferrées — ça n'arrive pas beaucoup dans le quotidien, mais c'est extraordinaire !
Cette référence à Stand by me n'est pas anodine, puisque Rob Reiner l'a adapté d'une nouvelle de Stephen King. Or Un vrai bonhomme touche au fantastique...
Dans Stand by me, il y a un méchant, un couteau, un cadavre, des histoires horribles ; le quotidien devient fantastique, le fantastique devient quotidien. Je ne sais pas si King raconte son enfance à lui, mais en tout cas, ça raconte l'enfance. J'avais envie de rendre un peu extraordinaire le quotidien, et de challenger les personnages avec des scènes un peu fortes, avec un peu d'action et un peu d'aventure. Modestement, bien sûr, c'est tout petit, mais j'en avais envie.
Dans le cosmos du cinéma français, ce genre de film n'existe pas ; il n'y a pas beaucoup non plus de films évoquant la construction adolescente — outre La Tête haute que vous évoquiez, mais dans un autre périmètre...
Même si mes influences sont américaines, elles sont aussi françaises. mais il est vrai que je ne trouve pas de modèle. Évidemment j'ai vu The Spectacular Now, avec Miles Teller qui joue dans Whiplash, — un de ces “Coming At Age” qu'on ne fait pas tellement en France. En France, justement, j'avais adoré Génial, mes parents divorcent !, qui était une sorte de Goonies français, avec à la place d'une aventure, la mission de saboter le mariage de plein de parents.
Le producteur en était Christophe Lambert, de culture américaine, ce qui explique les choses...
Exactement ! J'avais aussi adoré Scout Toujours : à la fin, c'est pas de la comédie, c'est de l'aventure. Dans ce film, les méchants sont tous un peu beaux gosses, comme les sportifs des films américains. Même Respire, c'est quand même un drame psychologique, donc effectivement il y a pas tellement de référents.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit que les ados ne vont plus au cinéma. Ils vont voir principalement les gros films américains. Les grosses comédies françaises les intéressent moyen : dans les teen movies à la française, on les prend pour des imbéciles. Entre le drame et la comédie débile, il y a justement le Coming At Age anglo-saxon que j'ai essayé de faire.
À quel moment avez-vous décidé qu'il fallait révéler la mort du personnage de Léo au spectateur ?
Très vite, on s'est dit qu'on ne faisait pas Sixième Sens ni Fight Club : le film ne repose pas sur cette surprise-là. Je ne voulais pas la faire à l'envers au spectateur ou en tout cas jouer avec lui et le choper — mais c'est ce qui se passe, et j'en suis assez content. Pour le coup, il y a deux camps : les gens qui ne voient rien arriver, et qui se prennent la scène dans la gueule, et c'est une des premières émotions fortes qu'ils ont, parce que là ils disent : « oh la vache ! » puis d'autres qui, ayant compris le truc, sont soulagés de voir que le film ne repose pas dessus.
Quand le scénario faisait 120 pages, ça arrivait à la 30-35e page, à la fin de l'acte 1. Et puis après, forcément, on a réduit le tout pour des raisons budgétaires, et ça arrive maintenant à la 18e minute. En tout cas, ça a toujours été clair et net pour moi que le film ne peut pas commencer sans qu'on sache clairement qu'il est mort. Donc il faut aller vite.
J'ai appris avec l'écriture à ne pas répondre aux questions que les gens ne se posent pas.
En l'occurrence, je ne me suis pas obligé à mettre plein d'indices pour dire que Léo est vivant — et finalement, on ne le voit que deux fois avant qu'on apprenne qu'il est mort.
Un vrai bonhomme aborde la question de la masculinité et de son affirmation, différente suivant les personnages. Comment avez-vous “tricoté“ ce thème dans l'écriture ? Le choix des comédiens a-t-il eu une incidence sur le sujet ?
Ce qui est marrant, c'est que je voulais faire un film là-dessus : le sujet était en moi depuis le court-métrage, sans être forcément très identifié. C'est en travaillant sur moi que j'ai compris mes frustrations d'adolescent, que finalement j'ai compris que j'avais toujours eu l'impression de ne pas être un homme, “un bonhomme“ parce que je ne me battais pas, je n'étais pas comme ci, ni comme ça.
Ensuite, la condition sine qua non pour faire le film, c'était qu'il s'agisse de l'histoire d'un mec petit s'appelant Tom comme Tom Pouce. Je cherchais donc un acteur petit. Thomas Guy n'est pas très grand, mais alors que le scénario était en train d'être écrit, je me suis dit que ce n'était pas une histoire de taille. Ce que je ressentais quand j'étais ado, ce n'était pas d'être petit — j'aurais pu être petit, trapu et hyper viril — mais j'avais l'impression de ne pas avoir les attributs faisant de moi un homme comme dans les BD, les romans, à la télé, sur les affiches... La taille est alors devenue moins importante, à mesure que le film s'est développé et le film a eu pour ainsi dire sa vie propre, même si j'ai été beaucoup influencé par un livre, Le Mythe de la virilité d'Olivia Gazalé, qui traite de cette question.
Vous utilisez beaucoup les éléments symboliques...
Le père, par exemple, lorsqu'il parle de ses éoliennes, il parle de la hauteur du mât, de la puissance des turbines... Tout ça est très phallique ; il est obsédé par ça. Évidemment quand il parle d'une puissance de 2 gigawatts, je n'ai pas pris le 2 pour rien : ce sont les testicules ! (rires). J'ai aussi essayé de faire en sorte que les personnages aient des codes vestimentaires liés aux super-héros. Le prune du blouson de Léo avec le T-shirt vert, ce sont les codes de Hulk ; quant au méchant, il a les couleurs de Captain America, et s'appelle Steve comme lui, d'ailleurs.
Je n‘ai pas eu la main assez lourde, j'aurais aimé être plus évocateur. Par exemple, pour montrer la pression que les garçons peuvent subir, je voulais en plus mettre des affiches de héros de guerre — le nom du lycée est celui d'un héros de la Première Guerre mondiale. Être entouré d'images d'hommes forts, ça a un impact, un conditionnement. Le père avait une gravure de Napoléon ou un buste. En fait, je ne voulais pas que les personnages parlent de masculinité, mais je voulais qu'elle soit là.